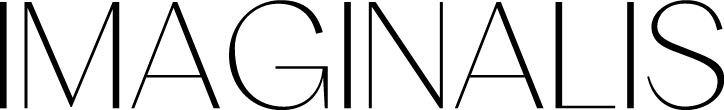- 27/12/2024
- By Soufiane Mezzourh
- 0 Comments
Quand les intelligences s’expriment : éduquer sans contraindre
Depuis un moment, l’intelligence artificielle fait tout le buzz. C’est la nouvelle star, celle dont tout le monde parle. Pendant ce temps, les autres « intelligences » se retrouvent snobées, reléguées dans les coulisses comme des figurants oubliés. Pourtant, nos petites galères du quotidien sont là pour nous rappeler une chose essentielle : l’intelligence humaine, c’est beaucoup plus qu’une histoire de QI ou d’algorithme.
Tenez, l’autre jour, un papa m’a confié, l’air désespéré, que son fils était « nul en maths ». Pour lui, c’était le début de la catastrophe. Mais voilà, ce même garçon passe des heures à dessiner des BD qui font rire tout le monde et à jouer de la guitare comme un pro. Alors, je n’ai pas pu m’empêcher de lui demander, un peu taquin : « Tu veux qu’il soit bon partout, c’est ça ? ». Il a ri, un peu gêné : « Bon, ok… peut-être pas ». Et là, je lui ai lancé : « Au fait, toi, tu voulais pas faire archi au lycée ? ». Il a haussé les épaules avec un sourire un peu nostalgique : « Si, mais tu sais, la vie… ». Je lui ai souri en retour : « Ah, on s’est compris ».
C’est justement là qu’est le problème : on a cette fichue habitude de mettre les gens – et surtout les enfants – dans des cases, en oubliant qu’il y a mille façons d’être intelligent. Et c’est précisément ce que Howard Gardner a voulu changer avec sa théorie des intelligences multiples. Son idée est simple, mais percutante : chaque personne a ses forces et son terrain de jeu. Certains sont doués en maths, d’autres en musique, en art, ou même en empathie ou en connexion avec la nature. Pas besoin d’être bon partout. L’essentiel, c’est de découvrir ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer, et d’aller à fond dans cette direction.
Les intelligences multiples de Gardner
Cette réflexion a pris une tournure marquante dans les années 80, quand Gardner, psychologue américain et prof à Harvard, a présenté sa théorie des intelligences multiples. En gros, il a dit : « Stop aux classements réducteurs, ouvrons les yeux sur la diversité des talents humains ». Selon lui, l’intelligence, c’est bien plus qu’un simple QI ou une aptitude scolaire. C’est un éventail de compétences, et chacune montre une facette unique de ce qu’on peut accomplir. En voici un petit tour d’horizon, avec des exemples pour mieux visualiser.
L’intelligence linguistique, c’est le pouvoir des mots. Ceux qui l’ont dans la peau sont des pros pour raconter des histoires, écrire des textes qui captivent ou jouer avec la langue. Imagine un écrivain qui transporte ses lecteurs, un avocat qui défend une cause avec passion, ou un orateur qui embarque son public avec sa tchatche.
L’intelligence logico-mathématique, elle, parle chiffres et logique. Les fans de cette intelligence adorent analyser des situations, dénicher des motifs et résoudre des problèmes. Pense à un mathématicien jonglant avec des équations, un chimiste mélangeant des solutions pour tester une théorie, ou un architecte qui planifie un bâtiment jusque dans les moindres détails.
L’intelligence spatiale, c’est l’art de voir et manipuler des formes dans sa tête. Les experts dans ce domaine brillent dans les arts visuels, la navigation ou le design. Par exemple, un architecte dessinant un immeuble, un peintre jouant avec les couleurs et les formes, ou un pilote traçant sa route dans le ciel.
L’intelligence musicale, c’est l’oreille absolue ou presque. Ces personnes sentent le rythme, les mélodies, et peuvent créer ou interpréter de la musique avec brio. On parle de compositeurs écrivant des symphonies, de musiciens virtuoses, ou de chefs d’orchestre orchestrant une harmonie parfaite.
L’intelligence corporelle-kinesthésique, c’est tout ce qui passe par le corps. Ces gens-là savent exprimer des idées ou accomplir des tâches physiques avec une précision folle. Un danseur qui enchaîne des mouvements fluides, un athlète qui pulvérise des records ou un chirurgien réalisant une opération délicate, voilà leurs terrains de jeu.
L’intelligence interpersonnelle, c’est l’art de comprendre et d’interagir avec les autres. Les pros de cette intelligence sont empathiques, bons communicateurs, et travaillent bien en équipe. Imagine un enseignant qui motive ses élèves, un leader qui inspire, ou un thérapeute qui capte les émotions de ses patients.
L’intelligence intrapersonnelle, c’est le voyage à l’intérieur de soi. Ces personnes ont une bonne connaissance d’elles-mêmes, savent ce qu’elles ressentent, ce qu’elles veulent et pourquoi. Un écrivain qui plonge dans ses émotions, un méditant en quête de pleine conscience, ou un entrepreneur qui connaît ses forces et ses faiblesses.
Enfin, l’intelligence naturaliste se connecte à la nature. Les amoureux de cette intelligence adorent reconnaître et classifier plantes et animaux. Un botaniste qui identifie des plantes rares, un écologiste qui protège les écosystèmes ou un agriculteur qui optimise ses cultures en harmonie avec la nature sont des exemples parfaits.
Le plus cool dans tout ça ? On a tous ces intelligences à des degrés divers. Et bonne nouvelle : on peut les développer et même les combiner. Un musicien qui écrit des paroles géniales, ou un chef cuisinier qui maîtrise ses outils tout en choisissant des ingrédients de saison, en sont de parfaites illustrations. Bref, passer d’une intelligence à l’autre enrichit notre façon de créer, d’apprendre, et de s’exprimer.
D’une intelligence à l’autre
Un auteur-compositeur-interprète est un super exemple de mélange entre l’intelligence linguistique et musicale. Il jongle avec les mots pour écrire des paroles qui touchent et les habille d’une mélodie qui reste en tête. C’est un combo gagnant qui fait vibrer son public. Pour arriver à ce niveau, il passe sûrement des heures à décortiquer des poèmes, à maîtriser les bases de la composition musicale et à composer encore et encore, jusqu’à trouver la formule magique.
Un architecte, lui, combine l’intelligence logico-mathématique et spatiale. Il calcule tout au millimètre pour que ça tienne debout, mais il imagine aussi des espaces où les gens ont envie de vivre. C’est un cerveau qui fait à la fois dans le concret et dans l’esthétique. Pour affûter ces compétences, il peut s’entraîner avec des exercices de géométrie, des logiciels de modélisation 3D, et relever des défis complexes qui poussent à réfléchir autrement.
Dans un tout autre registre, un danseur de troupe illustre bien le duo entre l’intelligence corporelle-kinesthésique et interpersonnelle. Il maîtrise son corps au millimètre près pour des mouvements fluides et précis, tout en restant hyper connecté aux autres danseurs. La clé pour lui, c’est de répéter encore et encore, mais aussi de bosser en groupe pour améliorer la coordination et la complicité sur scène.
Enfin, l’écologiste, c’est le mariage parfait entre l’intelligence naturaliste et intrapersonnelle. Il est à l’écoute de la nature et de ses écosystèmes, mais il est aussi en phase avec ses propres valeurs et motivations, ce qui guide ses actions pour préserver l’environnement. Entre des balades d’observation, l’étude approfondie des sciences naturelles et des moments de réflexion ou de méditation, il affine son approche jour après jour.
Dans tout ça, les enseignants, coachs et conseillers en orientation ont un rôle clé. Ils peuvent identifier les forces uniques de chaque élève et adapter leurs méthodes pour leur permettre de jongler entre plusieurs formes d’intelligence. Avec un bon coup de pouce, chaque enfant peut développer ses talents à fond et apprendre de façon plus riche et sur-mesure.
Prenons la pédagogie différenciée, par exemple. Elle permet de proposer plein d’activités différentes qui font appel à plusieurs intelligences en même temps. Un prof peut, par exemple, organiser des ateliers où les élèves bossent en petits groupes sur des projets mêlant écriture (linguistique), calculs (logico-mathématiques) et dessins (visuo-spatial). C’est super parce que ça reconnaît que chaque élève a sa propre manière d’apprendre et que ce n’est pas forcément en suivant tous le même chemin qu’on arrive à bon port. Avec cette approche, fini l’idée selon laquelle tout le monde doit avancer au même rythme ou travailler de la même façon.
Autre façon de faire, les jeux-cadres de Thiagi, une approche ultra fun pour rendre les sujets complexes bien plus accessibles. Ces jeux, qui se déroulent en étapes courtes, mélangent activités individuelles, travail en petits groupes et réflexions collectives. Le résultat ? Les élèves sont à fond, motivés, et apprennent presque sans s’en rendre compte. Que ce soit pour découvrir un nouveau concept, résumer une leçon ou réviser, ces jeux rendent l’apprentissage dynamique et interactif.
En combinant ces différentes approches, les éducateurs ouvrent tout un monde de possibilités aux enfants. Ils les aident à découvrir leurs forces, à renforcer leurs compétences et à se préparer pour réussir dans des contextes variés. Bref, on apprend mieux quand on s’amuse, qu’on échange et qu’on explore !
Au-delà de la controverse scientifique
La théorie des intelligences multiples de Howard Gardner a fait pas mal de vagues dans le monde scientifique. Certains chercheurs ont pointé du doigt le manque de preuves béton pour prouver que ces intelligences sont vraiment distinctes, en disant qu’elles ne sont peut-être pas si indépendantes les unes des autres. D’autres reprochent à la théorie d’être un peu trop subjective dans la façon dont elle définit et classe les différentes formes d’intelligence. Bref, ça n’a pas convaincu tout le monde.
Cela dit, des études récentes, notamment en neurosciences, viennent remettre les pendules à l’heure. On a découvert des réseaux neuronaux spécifiques pour différentes fonctions cognitives, ce qui donne du poids à l’idée que, oui, il existe bien plusieurs formes d’intelligence, interconnectées mais assez uniques. En gros, tout le monde a son petit « mix » de forces et de faiblesses, et c’est cette diversité qui rend la chose super intéressante.
Du coup, même avec les critiques, la théorie des intelligences multiples reste un super outil pour repenser l’éducation. En identifiant les intelligences où quelqu’un excelle, on peut personnaliser les façons d’apprendre, et ça marche mieux pour tout le monde. En plus, ça met en lumière des talents qui passent souvent sous le radar des systèmes traditionnels, comme la créativité ou l’intelligence naturaliste. Résultat : une vision plus large, plus inclusive, et franchement, bien plus humaine de ce que veut dire « être intelligent ».
Nullité, prédisposition et autres mythes toxiques
Pour les éducateurs et les parents, l’idée, c’est de voir et d’encourager les multiples talents et formes d’intelligence que chaque enfant peut avoir. En les observant de près – ce qui les intéresse, ce dans quoi ils brillent sans trop d’effort – on peut repérer leurs zones de confort et leurs vraies passions. Et une fois qu’on les a repérées, hop, on les pousse à explorer et à creuser dans ces domaines. Ça booste leur confiance – et plus généralement ce qu’on appelle le « Sentiment d’efficacité perçue » (SEP) – et leur donne envie de s’épanouir à fond !
Mais attention, pas question de mettre les intelligences en compétition ! Chaque type d’intelligence a son importance et joue un rôle essentiel dans le développement global d’un enfant. Si on commence à privilégier une intelligence (genre les maths) et à en dénigrer une autre (comme l’art ou la nature), on passe à côté de tout un potentiel. L’idée, c’est de laisser chaque enfant s’éclater et se réaliser dans ce qui le motive vraiment, que ce soit en jouant d’un instrument, en résolvant des problèmes, en se connectant aux autres ou en explorant le monde qui l’entoure.
Pour revenir à mon anecdote sur le papa qui avait vite fait de classer son fils dans la catégorie des « nuls en maths », il est indispensable de reprendre ce genre de jugement hâtif et souvent injuste. Et pour ça, il faut creuser sur deux fronts. D’abord, côté apprenant : est-ce que les blocages viennent d’une angoisse plus profonde, voire d’une peur des maths qui pourrait être en partie innée ou renforcée par une expérience passée ? On sait que l’angoisse face aux chiffres a parfois des racines insoupçonnées, y compris d’ordre génétique. Ensuite, côté enseignant : est-ce que la méthode utilisée ne tourne pas en rond avec des outils et techniques purement logico-mathématiques ? Parce que si on veut vraiment aider un enfant, il faut lui ouvrir un éventail de possibilités, lui montrer qu’il existe mille chemins pour comprendre, et pas juste une autoroute où, s’il dérape, c’est l’accident assuré !
Aujourd’hui, avec Internet, on trouve des tonnes de vidéos d’éducateurs qui abordent les maths autrement. Ils utilisent des approches créatives, parfois complètement décalées, pour résoudre des problèmes, qu’ils soient super simples ou hyper compliqués. Ce qui ressort souvent, c’est que le « problème » ne vient presque jamais de l’enfant, mais bien de la manière dont on lui présente les choses. Et mieux encore : ces vidéos montrent qu’un problème mathématique peut être simplifié, voire résolu, grâce à un détour par une autre forme d’intelligence. Par exemple, visualiser un problème en dessinant ou en manipulant des formes (intelligence spatiale), ou encore le traduire en rythme ou en musique (intelligence musicale).
En gros, il faut en finir avec l’idée que les maths – ou n’importe quel autre domaine de connaissance, d’ailleurs – seraient réservés à ceux qui auraient une « prédisposition naturelle », à ceux qui auraient une « tête à ça ». En changeant d’angle et en cassant les vieilles habitudes pédagogiques, on découvre qu’il n’y a pas de « nullité », juste des approches qui ne collent pas avec le mode de fonctionnement de l’enfant. Et c’est là que réside la clé : diversifier les méthodes, jouer sur les complémentarités des intelligences et redonner à chacun une chance de réussir.
Crédit Photo : Tang Eau Hoong