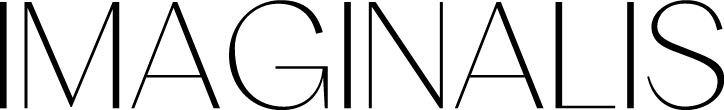- 17/05/2024
- By Soufiane Mezzourh
- 0 Comments
L’entrepreneur existentialiste : leçons sartriennes
C’est précisément de ce genre d’enfermement qu’il faut se méfier face à l’idée d’une essence de l’entrepreneuriat qui risque à son tour de figer l’entrepreneur dans un idéal-type. Celles et ceux qui cherchent par exemple à savoir ce qu’est un « vrai » (true) entrepreneur ne semblent pas viser autre chose. À coup de profilage et autres tests de personnalité, le portrait de l’entrepreneur génial finit par être taillé dans le marbre : curiosité, créativité, adaptation, conscience de soi, courage, prise de risque, résilience, etc. Nous sommes ici à deux traits du culte du héros de Carlyle.
Pour quelqu’un comme Saras Sarasvathy, auteure de la théorie de l’effectuation, le mythe de l’entrepreneur rationnel et divinateur, figure héroïque et solitaire, porteur de la grande idée qu’il planifie puis exécute avec succès, a vécu même s’il tend à persister, d’une part, en filigrane d’approches pédagogiques désemparées et, d’autre part, comme idéologie du développement économique à tout prix. Les mythes survivent parfois par confort, faute de recours. La théorie de l’effectuation, proposée par Sarasvathy depuis une vingtaine d’années, constitue un de ces recours et peut être considérée comme profondément existentialiste (au sens de Sartre). Elle prend pour prémisse un avenir non prédictible et envisage l’entrepreneuriat comme un exercice de transformation des moyens dans l’élaboration des fins. Il s’agit donc de rechercher les « effets » possibles de moyens donnés. Les objectifs de l’entrepreneur émergent au fur et à mesure de l’avancée du projet entrepreneurial en fonction de l’aspiration et des connaissances du fondateur, des rencontres et réseaux mobilisés et de diverses contingences. C’est précisément ce que Sartre veut dire lorsqu’il définit l’homme comme un « projet ».
Selon Sartre, c’est ici que le danger pointe à l’horizon : lorsqu’une « situation » (l’innovation en est une) se mue en « détermination ». Bien entendu, Sartre n’est pas naïf, il sait bien que les hommes ont tous une histoire et une nature. Ce qu’il veut dire, au fond, c’est que les humains ne se laissent réduire ni à leur histoire ni à leur nature, c’est pourquoi il introduit une distinction cruciale entre « situation » et « détermination ». Nous sommes toujours, cela va de soi et nul ne saurait le nier sans nier la réalité, « en situation ». Il y a bien entendu une « condition humaine » : je suis né homme ou femme, dans tel milieu social, dans telle nation, dans telle culture et telle langue, dans telle famille, etc. Je suis donc toujours déjà inscrit au sein d’une situation particulière qui, du reste, peut éventuellement se muer en détermination. Mais cette situation ne se transforme pas forcément en détermination, elle ne saurait se confondre avec une privation totale de liberté : ce n’est pas parce que je suis née femme que je suis obligée de vivre dans la domesticité, rivée à ma cuisine et à l’éducation de mes enfants. Ce n’est pas parce que je viens au monde prolétaire que je deviendrai nécessairement un « rouge » ou un révolutionnaire.
Pas de faux-fuyants non plus pour l’entrepreneur existentialiste car il est de « bonne foi ». Il sait faire la part des choses et se refuse d’invoquer une quelconque essence ou catégorie absolue – LA conjoncture, LA politique, LA famille, LA poisse, etc. – qui pourrait compromettre son agir entrepreneurial et sa liberté. Tout le contraire de la mauvaise foi de l’entrepreneur essentialiste qui est un joueur : il « joue » à l’entrepreneur comme ce garçon qui se plaît à jouer au « garçon de café » dans L’Être et le Néant : « Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide, il vient vers les consommateurs d’un pas un peu trop vif, il s’incline avec un peu trop d’empressement, sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Enfin, le voilà qui revient en essayant d’imiter, dans sa démarche, la rigueur inflexible d’on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu, qu’il rétablit perpétuellement d’un mouvement léger du bras et de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu ». Il se donne tous les traits, toutes les manières caractéristiques de sa profession, pour être parfaitement conforme à ce qu’il s’imagine être son essence. Le malheureux s’efforce de faire en sorte que le moindre de ses gestes soit en tout point adéquat au rôle social dont il s’est imaginé qu’il doit lui coller à la peau.
Pourquoi le garçon de café est-il un peu trop empressé ? Ce « trop », qui revient à maintes reprises dans le texte, vient souligner l’idée que le serveur s’efforce de nier sa liberté. Ce « trop » est le lieu même de la mauvaise foi : « mauvaise » parce que en vérité, le garçon sait très bien qu’il n’est pas que garçon de café, que c’est un jeu, et c’est pourquoi il en fait d’ailleurs trop. Il en va de même de l’entrepreneur essentialiste qu’on reconnaît lui aussi à son attitude apprêtée car il sait, au fond, que le modèle qu’il se plaît à singer – idéal-type (tel que décrit par Carlyle, Schumpeter et Drucker) ou réel (Musk, Zuckerberg, Chesky, Oprah…) – est une fiction. L’entrepreneur existentialiste, lui, incarne pour ainsi dire son propre rôle et se taille un portrait à sa mesure.