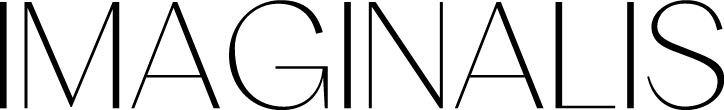Mobile Menu
- 22/09/2023
- By Soufiane Mezzourh
- 0 Comments
Le paradoxe de l’entrepreneuriat féminin
Je me suis toujours méfié du comparatisme femmes-hommes aussi bien dans son ancrage biologique que dans son verrouillage psychologique. Dès que j’entends quelqu’un dire « LES femmes sont… » ou « LES hommes sont… », je sais que l’essentialisme nous attend au tournant (« That train is never late », comme disent les américains). Il faut dire que les stéréotypes sont bien plus tenaces qu’on ne le pense : « les femmes sont multitâches », « les hommes ne savent faire qu’une chose à la fois », « les femmes sont plus douées pour les langues », « les hommes sont plus doués pour les maths », « les femmes sont plus émotives », « les hommes sont plus rationnels », « les femmes privilégient leur vie familiale » , « les hommes ont plus d’ambition professionnelle »… Bref, ce genre de généralisations abusives.
Pourtant, il m’arrive encore d’en croiser. Dans les conversations de bistrot, bien sûr, mais aussi dans la littérature savante et dans les médias. Prenons à titre d’exemple l’émission « Gros plan sur l’entrepreneuriat féminin » diffusée le 16 Mars 2023 sur la chaîne Médi1 TV. Pendant le débat, la journaliste Khadija Ihssane reprend un des intervenants après avoir insinué l’existence d’un entrepreneuriat « féminin » qui serait distinct de l’entrepreneuriat pratiqué par les hommes. Je cite : « Est-il prouvé scientifiquement qu’il existe deux entrepreneuriats dissemblables ? », s’interroge suspicieusement la journaliste à voix haute. Question perspicace à laquelle son interlocutrice (professeure universitaire) répond aussitôt par l’affirmative en expliquant qu’il existe de fait un entrepreneuriat typiquement « féminin », de même qu’un leadership « féminin » et un style de management « féminin ». J’ai tiqué sur le moment. J’avoue. À ma connaissance, l’entrepreneuriat (comme tout autre métier) n’était ni sexué ni genré. Quoi qu’il en soit, le débat – fort intéressant par ailleurs – m’a donné envie d’en savoir un peu plus sur l’entrepreneuriat féminin, et plus particulièrement sur ce qu’il avait, pour ainsi dire, de proprement « féminin ». En gros, deux revendications fortes et à première vue paradoxales sont présentes dans le corpus académique et dans le débat public : une revendication d’égalité des droits et des chances et une revendication d’inégalité de genre et des aptitudes.
Selon la première revendication, l’entrepreneuriat féminin – comme métier et objet d’étude – œuvre pour la reconnaissance et pour la valorisation du travail accompli par les femmes entrepreneures ainsi que leur contribution au développement économique et social tout en dénonçant les inégalités (économiques, sociales, culturelles, institutionnelles, etc.) qui pèsent sur les femmes entrepreneures et qui entravent leur développement aussi bien personnel que professionnel. Devant cette première revendication d’égalité des droits et des chances, il est de notre devoir à tous de dénoncer avec force et de corriger ces inégalités sous toutes leurs formes et dans toute leur étendue en saluant au passage le travail prodigieux accompli par les femmes entrepreneures, par la communauté scientifique, par les institutions tout en brandissant haut et fort les étendards du féminisme libéral, du féminisme social et du féminisme socio-constructionniste qui ont révolutionné la pensée entrepreneuriale durant les trois dernières décennies.
Parallèlement, l’entrepreneuriat féminin se réclame d’une étoffe qui se veut différente de celle de l’entrepreneuriat pratiqué par les hommes. Selon cette seconde revendication, il y aurait donc un entrepreneuriat typiquement « féminin » qui se distingue par des traits de personnalité et des styles de management que les femmes entrepreneures incarnent, sinon « mieux » que les hommes entrepreneurs, du moins différemment. Cette thèse part du postulat selon lequel notre comportement diffère selon le sexe et selon le genre. Selon le sexe, parce que les femmes et les hommes présentent des disparités au niveau chromosomique, anatomique et hormonal, lesquelles vont influer sur leurs manières respectives de penser et d’agir. Et selon le genre, car nos humeurs et nos actes diffèrent également en fonction du degré de « féminité » et de « masculinité » que nous nous attribuons (en référence aux « échelles F-M », tel que le célèbre Bem Sex Role Inventory).
Selon l’anthropologue américaine Helen Fisher, ces disparités sont des atouts et doivent être revendiqués comme tels par les femmes : « In my research, I have identified some talents that women express more regularly than men; aptitudes that stem, in part, from women’s brain architecture and hormones, skills that leadership theorists now espouse as essential to leadership effectiveness ». De même, Candida Brush, figure de proue de l’entrepreneuriat féminin, nous invite dans la même veine à marquer le contraste entre les femmes et les hommes, au lieu de gommer leur dissemblance, en soutenant par exemple qu’à la différence des hommes, les femmes ne séparent pas leurs affaires de leurs vies personnelle et familiale et qu’elles cherchent, au contraire, à établir des ponts entre toutes ces sphères, ou que les femmes n’adoptent pas les mêmes critères de réussite (professionnelle) que ceux mobilisés par les hommes. Le but n’étant pas d’amener les femmes à entreprendre « comme les hommes », mais d’insister sur l’aspect singulier et positif que représente l’approche féminine pour le champ de l’entrepreneuriat.
Ce point de vue ne fait pas l’unanimité si l’on en croit la neurobiologiste britannique Gina Rippon qui récuse pour sa part toute différence biologique entre cerveau masculin et cerveau féminin, affirmant que « le cerveau n’est pas plus sexué que le foie, les reins ou le cœur ». Selon Rippon, il n’est pas prudent de prétendre qu’il existe des différences entre les femmes et les hommes sous prétexte d’être « câblés » différemment et que les femmes seraient par exemple plus douées pour le langage, les hommes plus performants en raisonnements spatiaux ou mathématiques, les deux sexes inégalement enclins à l’empathie, etc. Ces thèses fantaisistes issues du mythe selon lequel « les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » sont infondées et dangereuses, explique Rippon, car elles mettent les gens dans des cases sur la base de leurs différences biologiques et comportementales (alors que seules 10% des connexions du cerveau sont établies à la naissance ; le reste se fait au cours du développement avec l’apprentissage, l’éducation, les interactions sociales, l’environnement et les expériences ; ce que les neurobiologistes appellent la « plasticité du cerveau »). C’est pourquoi « un monde genré produira un cerveau genré », nous avertit la chercheuse britannique. Certes, il existe des différences indéniables entre les femmes et les hommes, au niveau chromosomique, anatomique ou hormonal, toutefois, cette disparité biologique tend à fléchir dès lors qu’il est question de capacités intellectuelles et de compétences. Le nier serait un « neurosexisme » pur et simple.
D’autres travaux scientifiques comme The Sexual Paradox de la psychologue canadienne Suzan Pinker, Pink Brain, Blue Brain de la neuroscientifique américaine Lise Eliot et Le Camion et la Poupée du biologiste français Jean-François Bouvet démontrent également que les facteurs biologiques et les facteurs sociaux s’affectent mutuellement. Certains environnements accentuent les différences biologiques et comportementales, alors que d’autres les atténuent en modifiant les structures neuronales qui, à leur tour, orienteront les choix et les actions des individus. En somme, ni déterminisme biologique, ni déterminisme social, puisque l’on admet aujourd’hui qu’avec la « plasticité cérébrale », le cerveau se modifie en fonction de son environnement.
C’est la raison pour laquelle il faut faire montre de prudence, pour revenir à l’entrepreneuriat, à chaque fois qu’on s’aventure sur le terrain glissant des disparités de sexe et des inégalités de genre, que ce soit pour affirmer par exemple que les femmes entrepreneures expriment une plus grande aversion pour le risque en comparaison avec les hommes entrepreneurs, que les hommes entrepreneurs sont motivés davantage par le gain financier alors que la question du statut (social) est plus déterminante chez les femmes entrepreneures, ou encore que l’intention de croissance (expansion) est plus forte chez les hommes entrepreneurs que chez les femmes entrepreneures. Certes, ces conclusions restent par définition partielles et « situées » (context-dependent), soulignent les chercheurs, dans la mesure où une multitude de facteurs (sociaux, culturels, institutionnels, etc.) entrent en jeu. Il n’en demeure pas moins vrai que formulés ainsi, ces énoncés sont au moins aussi problématiques que ceux dénoncés par Gina Rippon et ses collègues, à savoir que ce type de comparatisme (femmes-hommes) a la fâcheuse tendance d’ « essentialiser » certaines propriétés chez les femmes et d’autres chez les hommes (sachant que l’aversion au risque, pour reprendre cet exemple, n’est pas caractéristique des femmes entrepreneures en tant que femmes, mais plutôt en tant qu’entrepreneures travaillant dans un environnement socioculturel contraignant). De ce point de vue, toute tentation d’innéisme doit être répudiée.
On voit bien que la seconde revendication de l’entrepreneuriat féminin n’est pas sans défaut. Le fait de suggérer ou d’affirmer qu’il existe un entrepreneuriat typiquement « féminin » qui serait singulier (au même titre qu’un style de management ou un leadership proprement « féminin ») peut conduire à une hérésie de langage capable de susciter, le cas échéant, une sorte de « sexisme » ou de « genrisme » entrepreneurial. Sachant que nous avons parfois tendance, comme on vient de le voir, à essentialiser certaines valeurs ou certaines capacités (la confiance, l’altruisme, la communication, la créativité…), certains traits de personnalité ou certains comportements (la vulnérabilité, l’aversion au risque, la résilience…), tantôt chez les femmes tantôt chez les hommes, alors qu’en réalité, ni les femmes ni les hommes n’ont la mainmise ni sur tel trait de personnalité ni sur telle capacité entrepreneuriale. Bien au contraire, les disparités de part et d’autre sont quasiment nulles quand on y regarde de plus près.
En langue anglaise, on trouve des énoncés qui prêtent moins à confusion pour désigner l’entrepreneuriat féminin : « Women entrepreneurs », « Female-run enterprises », « Women-led businesses » ou encore « Women-owned companies » où l’accent est mis davantage sur le leadership lorsqu’il est porté par des femmes ou sur la propriété d’entreprise quand elle est détenue par des femmes plutôt que sur l’idée d’un entrepreneuriat féminin qui repose sur des modes de pensée et d’action sui generis et qui laisse entendre, du coup, l’existence d’un entrepreneuriat « féminin » d’un côté, et d’un entrepreneuriat « masculin » de l’autre. Manière de « sexiser » ou de « genriser » la chose à outrance. Ce qui serait absurde. De la même manière qu’il serait grotesque de parler de comptabilité « féminine » ou de physique « féminine » des particules. Car ce sont des sciences, des disciplines, des métiers… pas des sorority cercles ou des boy’s clubs.