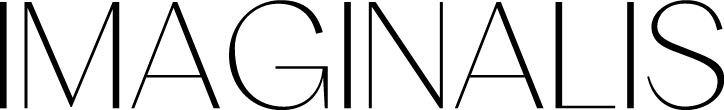- 03/08/2025
- By Soufiane Mezzourh
- 0 Comments
Le mythe du leadership
Dans Mythologies, Roland Barthes s’amusait à disséquer les objets du quotidien — la Citroën DS, le bifteck-frites, le catch — pour en révéler les coulisses idéologiques. Pour chaque cas, il appliquait une méthode en trois temps : la forme (ce qui se donne à voir), le concept (ce que ça prétend dire) et la signification (ce que ça cache vraiment). Aujourd’hui, les biftecks sont vegan, les catcheurs font des TED Talks, et le mot « sens » est devenu un argument commercial. Mais les mythes, eux, n’ont pas disparu : ils ont simplement changé de costume. Dans la suite de notre série Mythologies barthésiennes, toujours en hommage un peu moqueur à Barthes, voici une petite autopsie du mythe du leadership.
La forme du leadership, c’est cette image soigneusement mise en scène qu’on nous sert à longueur de slides et de posts LinkedIn. Un homme ou une femme debout, sourire confiant, bras ouverts, prêt à « accueillir » tes idées comme on accueille un chiot adopté. On trouve le leader cool, façon Steve Jobs ou Elon Musk, col roulé noir ou t-shirt minimaliste, baskets blanches immaculées, posture de rockstar tech et carnet Moleskine toujours prêt à capturer une « fulgurance » censée changer le monde (ou au moins ton département). Ce spécimen aime parler de « disruption », balancer un « Think Different » avant sa gorgée de matcha, et poser sur des photos de retraites silencieuses ou de hackathons spirituels, l’air grave et détendu à la fois.
Et puis on a le leader plus classique, style Jack Welch ou David Solomon, en costume trois pièces impeccable, montre clinquante et regard de chasseur de primes. Celui-là ne prétend pas t’« inspirer » ou te « révéler », mais plutôt te « challenger », te « rationaliser » et « couper les branches mortes » (comprendre : toi, ton équipe et tes pauses café). Qu’ils soient en baskets arty ou en souliers vernis, tous arborent les mêmes hashtags #Vision, #Authenticité, #LeadTheChange et ponctuent leurs journées de selfies corporate ou de marathons solidaires (pour les plus photogéniques). Bref, un hybride de gourou bienveillant ou de petit César calculateur, d’athlète du dimanche ou de croqueur de tableaux Excel, tout ça parfumé à l’huile essentielle d’eucalyptus ou au cigare cubain, selon l’humeur du moment.
Le concept, lui, se veut noble et rassurant. Le leader serait ce phare ultime, cette boussole humaine qui éclaire notre route quand nous nous égarons dans l’open space. Il « inspire », il « révèle » le potentiel, il « aligne » (on ne sait toujours pas exactement quoi, mais ça fait sérieux). Sans lui, paraît-il, nous serions condamnés à errer comme des zombies sous caféine, incapables de comprendre notre Trello ou d’ouvrir un fichier Excel sans sombrer dans le néant existentiel. On nous vend le concept du leadership comme un remède miracle, une potion magique pour transformer un troupeau d’employés fatigués en communauté vibrante et « purpose-driven ».
Pour ancrer ce concept dans nos esprits, la forme se déploie surtout dans ces grandes messes modernes, façon keynote ou all-hands meeting, où le leader se met en scène comme une rockstar spirituelle. On le voit sur scène, seul sous un halo de lumière, micro-casque collé à la joue, marchant lentement de gauche à droite pour bien montrer qu’il « incarne la vision ». Steve Jobs l’a immortalisé avec ses keynotes devenues des shows quasi religieux ; Jeff Bezos raffole des all-hands meetings chez Amazon pour rappeler que « it’s always day one » (pendant que tout le monde vérifie si le badge d’accès fonctionne encore). Sundar Pichai, lui, adore les town halls à la Google, ponctués de grands sourires et de « thank you for the great question » (avant d’enterrer ton projet préféré). Chaque geste est millimétré, chaque pause lourde de pseudo-profondeur, comme s’ils revenaient d’un jeûne spirituel de trois jours dans le désert. Le tout ponctué de punchlines recyclées, du genre « Ose échouer pour mieux réussir » ou « Sois le changement que tu veux voir dans tes KPI », sur fond de musique planante. Ces shows transforment la foule en une armée de disciples fascinés, tout heureux d’applaudir leur propre condition, emballée dans un storytelling de « développement personnel » sauce corporate.
Mais la vraie signification, celle qu’on préfère ne pas trop gratter, c’est qu’on veut nous persuader que nous avons absolument besoin d’un leader pour survivre. Sans lui ou elle, pas de cap, pas de vision, pas d’espoir. Comme si, sans cette figure lumineuse, nous étions tous des poules sans tête, incapables de trouver la machine à café ou de cliquer sur « envoyer » dans Slack. C’est un récit pratique, qui arrange tout le monde : pendant qu’on admire le grand guide et qu’on applaudit ses citations pseudo-profondes, on oublie de se demander si, collectivement, on ne pourrait pas réfléchir et avancer tout aussi bien — voire mieux. La signification profonde du mythe du leadership, c’est ce vieux refrain astucieusement relooké : « Suis-moi, sinon tu es perdu ». Une belle façon de nourrir un ego déjà boursouflé tout en maintenant une hiérarchie bien douillette, le tout emballé dans un joli discours d’émancipation.
On le voit quand une entreprise entière se présente comme « l’incarnation » vivante de son fondateur : Tesla serait impossible sans Musk, Apple aurait disparu dans une faille spatio-temporelle sans Jobs, et Virgin s’effondrerait en poussière cosmique sans Richard Branson. Mais attention, ce n’est jamais le leader lui-même qui le dit — voyons, il est beaucoup trop humble pour ça. Ce sont toujours les autres : les employés émus qui expliquent qu’ils « n’auraient jamais osé sans lui », les actionnaires qui tremblent à l’idée de perdre leur messie, les partenaires stratégiques qui jurent qu’« il voit toujours cinq coups d’avance », ou encore les amis de passage qui se transforment soudain en prophètes de bistrot. Bref, tout un petit chœur de suiveurs fascinés qui entonne en boucle la même berceuse : « Sans lui, tout s’écroulerait ». Une chorale parfaitement orchestrée, pendant que le principal intéressé hoche la tête d’un air grave, genre « oh non, je ne fais que mon humble devoir », tout en savourant chaque note.
Et pour bien ancrer cette idée, on adore nous servir l’image du chef d’orchestre. Le leader serait ce maestro élégant, baguette en main, qui d’un geste précis fait surgir l’harmonie, dompte les cuivres, caresse les violons et évite la cacophonie. Sans lui, tout partirait en vrille, chacun jouerait sa petite improvisation nerveuse, et le concert ressemblerait à une fanfare de village au lendemain de fête. Une métaphore séduisante, facile à avaler, qui flatte autant le chef que son public.
Mais surprise : même cet argument a ses failles. Il existe des ensembles, comme l’Orpheus Chamber Orchestra, qui jouent sans chef d’orchestre depuis des décennies — et qui le font merveilleusement bien. Là-bas, chacun est responsable, chacun écoute, chacun ajuste son jeu en fonction des autres. La discipline est collective, la réussite est le fruit d’une écoute mutuelle et d’un engagement partagé. Et pourtant, ça fonctionne, ça vibre, ça touche. Dans le monde du business, il est tout à fait possible d’imaginer des organisations qui fonctionnent de la même façon (ex. entreprise autogérée, entreprise libérée, etc.) : sans figure charismatique unique, mais avec un véritable esprit coopératif et une intelligence collective assumée. Comme quoi, on peut parfaitement faire frissonner la salle (et signer quelques gros contrats au passage) sans gourou en costume trois pièces pour agiter la baguette.
Au fond, le leadership est largement overrated — ou, pour ceux qui préfèrent la langue de Molière, sacrément surestimé ! Plutôt que de courir derrière un guide à idolâtrer, on ferait peut-être mieux d’adopter le modèle de l’Orpheus : chacun maître de son art, chacun responsable, chacun partie indispensable d’un tout vivant et sincère. Plus besoin de prophète pour te dire quand jouer ou quand te taire ; tu deviens à la fois musicien, auditeur et bâtisseur du collectif. Et au final, l’harmonie n’en est que plus authentique. Aucune astreinte ne m’a contraint de jurer sur les paroles d’un maître*, disait le sage. À méditer, avant de liker la prochaine citation inspirante sur les réseaux.
*Nullius addictus iurare in verba magistri. Citation d’Horace (Épitres, I, 1, 14).
Crédit Photo – The Orchestra Conductor by Rogue Design