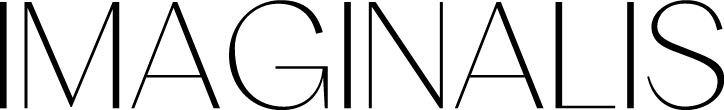- 12/10/2024
- By Soufiane Mezzourh
- 0 Comments
Le « Cygne Sombre » : Taleb, Deleuze et Fitzgerald
Dans son ouvrage Le Cygne Noir, Nassim Nicholas Taleb propose une théorie sur l’imprévisibilité des événements extrêmes, soulignant l’incapacité des modèles statistiques traditionnels à anticiper ces bouleversements inattendus. Bien que Taleb mette l’accent sur des explications liées à la rareté historique et aux lacunes informationnelles, il est possible d’envisager une interprétation plus radicale, inspirée de la philosophie de l’événement de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Ces derniers, dans Mille Plateaux, décrivent une conception originale de l’événement, fondée sur un « oubli fondamental » qui échappe à la perception humaine. Dans cette philosophie, les cygnes noirs suivent une structure narrative particulière, proche de celle des nouvelles (short stories) : tout comme l’événement de « rupture » dans la nouvelle de Fitzgerald (The Crack Up), ils émergent soudainement et viennent bousculer le « qu’est-ce qui s’est passé ? », laissant cette question ouverte, sans réponse définitive. En effet, une nouvelle ne résout jamais complètement le mystère autour de son événement central, et de la même manière, un cygne noir ne trouve son explication que rétrospectivement, après avoir renversé les certitudes. En combinant les approches de Taleb et de Deleuze-Guattari, ce texte propose de prolonger la réflexion sur l’imprévisible, tout en revisitant brièvement la critique de l’inductivisme, de Hume à Popper, en passant par Russell et leurs histoires de piafs.
La dinde de Bertrand Russel
La sagesse populaire selon laquelle « Pour prévoir l’avenir, il faut connaître le passé » (disait Machiavel), n’est pas toujours de bon conseil. C’est ce que nous enseigne Bertrand Russell (1872-1970) dans son livre Problèmes de philosophie (1912) à travers la fable cruelle mais amusante de la « dinde inductiviste » : dès le matin de son arrivée dans la ferme pour dindes, une dinde s’aperçut qu’on la nourrissait à 9 heures du matin. Toutefois, en bonne inductiviste, elle ne s’empressa pas d’en conclure quoi que ce soit. Elle attendit d’avoir observé de nombreuses fois qu’elle était nourrie à 9 heures du matin, et elle recueillit ces observations dans des circonstances fort différentes, les mercredis et jeudis, les jours chauds et les jours froids, les jours de pluie et les jours sans pluie. Chaque jour, elle ajoutait un autre énoncé d’observation à sa liste. Sa conscience inductiviste fut enfin satisfaite et elle recourut à une inférence inductive pour conclure : « Je suis toujours nourrie à 9 heures du matin ». Hélas, cette conclusion se révéla fausse d’une manière indubitable quand, une veille de Noël, au lieu de la nourrir, on lui trancha le cou !
Le raisonnement par induction, qui part de l’expérience pour mieux prévoir l’avenir, est donc parfois fallacieux, met en garde Bertrand Russell. Une inférence inductive avec des prémisses vraies (tous les jours, un repas à 9 heures) peut conduire à une conclusion fausse. La croyance inébranlable que l’avenir sera semblable au passé est illusoire, ou du moins faut-il l’appréhender avec distance : « L’homme qui a nourri la dinde tous les jours de sa vie finit par lui tordre le cou, montrant par là qu’il eût été bien utile à la dinde d’avoir une vision plus subtile de l’uniformité de la nature », écrit Russell. Faute d’avoir tous les éléments en sa possession, la dinde se fait piéger. Morale de l’histoire : il existe des erreurs de jugement inhérentes à toute forme de connaissance tirée de l’observation, car une observation a toujours de multiples facettes, dont nous n’avons pas forcément conscience.
Avant Russel, le philosophe écossais David Hume (1711-1776) savait très bien lui-même, et c’est pourquoi il était sceptique, que le raisonnement par induction ne pouvait jamais conduire à une certitude absolue. Je peux avoir observé mille fois que l’eau bout à cent degrés, sans être absolument certain que la mille et unième fois elle va en faire autant, ni être absolument certain que, dans des conditions un peu différentes, elle fera la même chose. Et c’est vrai que si je monte en haut des Alpes, l’eau ne bouillira plus à cent degrés, et la proposition générale sera justement falsifiée. Donc, la répétition des observations ne conduit jamais à une certitude absolue. Voilà pourquoi Hume considérait que toute science, parce qu’elle repose sur le raisonnement par induction, sur l’observation empirique, n’est qu’une croyance parmi d’autres. Car dans cette perspective empiriste, la science ne parvient jamais qu’à des probabilités : je tiens pour vraie la proposition « l’eau bout à cent degrés » parce que j’y crois, et j’y crois pourquoi ? Parce que j’ai observé la répétition de cette expérience des centaines de fois et que, tout simplement, j’attends qu’elle se reproduise à nouveau. Je tiens pour vrai que l’eau bout à cent degrés, parce que j’ai l’habitude d’observer que l’eau bout à cent degrés, mais c’est une croyance, c’est une attente, une expectation, une probabilité.
Les cygnes blancs de Karl Popper
Aux yeux du philosophe autrichien Karl Popper (1902-1994), Hume a raison au moins sur un point. Si on fonde la science tout entière sur l’observation, sur le raisonnement par induction, alors, en effet, il va de soi que nous ne parvenons jamais à aucune certitude. Je m’attends à ce qu’il fasse jour demain, parce que maintenant c’est la nuit, mais au fond, je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, si on procède de cette manière-là, avec cette idée que la répétition des expériences va vérifier progressivement, ou augmenter la probabilité de vérité d’une proposition, d’une hypothèse, alors évidemment, on est conduit au scepticisme. Mais, dit Popper, la science ne procède pas ainsi. Ni comme chez Descartes, par une chaîne d’évidences ou de certitudes, ni comme chez Hume comme une chaîne de vérifications par induction, par répétitions de séquences observées, mais la science procède par conjectures et réfutations.
Popper soutient que l’inférence procédant par généralisation, partant d’énoncés singuliers – compte rendus d’un nombre étendu d’observations ou d’expériences – pour conclure à des énoncés universels (lois ou théories), ne repose sur aucun fondement. Dans son livre Conjectures et réfutations (1963), Popper donne un exemple devenu célèbre pour illustrer sa critique. Soit la proposition : « Tous les cygnes sont blancs ». Je peux (attitude empiriste) essayer de vérifier la proposition en faisant des observations dans les lacs, à Londres ou ailleurs. Je vais observer, je vais accumuler dix mille, cinquante mille, cent mille cas de cygnes blancs, et j’aurai de plus en plus le sentiment que la proposition est, sinon absolument certaine, du moins de plus en plus probable. J’aurai accumulé ce que je prends pour des « vérifications ». Bien évidemment, je ne parviens pas de cette manière-là à une certitude absolue, mais enfin, il m’apparaît comme probable que tous les cygnes sont blancs. En revanche, dit Popper, si je vois un seul cygne noir (et il existe bel et bien des cygnes noirs), à bec rouge en plus, alors je sais une fois pour toutes et absolument que la proposition « tous les cygnes sont blancs » est fausse. Là, j’ai une certitude absolue. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c’est qu’on y voit apparaître l’une des thèses centrales de Popper : il y a dissymétrie entre le vrai et le faux. En effet, si je n’ai jamais de certitude absolue s’agissant de la vérité, en revanche, s’agissant de l’erreur, je puis être absolument certain. Je suis totalement certain que la proposition « tous les cygnes sont blancs » est fausse. Si étendu que soit le nombre d’observations sur lequel s’appuie l’induction, nous explique Popper, la conclusion transcendant toutes les observations reste toujours conjecturale : « il est loin d’être évident d’un point de vue logique, que nous soyons justifiés d’inférer des énoncés universels à partir d’énoncés singuliers aussi nombreux soient-ils ; toute conclusion tirée de cette manière peut toujours, en effet, se trouver fausse ; peu importe le grand nombre de cygnes blancs que nous puissions avoir observé, il ne justifie pas la conclusion que tous les cygnes soient blancs ». L’induction n’a donc aucune validité scientifique aux yeux de Popper.
Le Cygne Noir de Nassim Taleb
Le problème de la « dinde inductiviste », imaginé par Bertrand Russell, et celui des « cygnes blancs », relaté par Karl Popper, sont repris et réinterprétés par le statisticien et essayiste libanais Nassim Nicholas Taleb dans Le Cygne Noir (2007), son ouvrage phare où il théorise le rôle central des événements rares, imprévisibles et aux conséquences extrêmes dans l’histoire. Taleb nous met en garde contre les dangers de l’induction : en se concentrant exclusivement sur le passé et le présent pour anticiper l’avenir, on finit par oublier les propriétés émergentes des systèmes complexes, les aspects chaotiques, et surtout, les limites de l’information à notre disposition, ainsi que celles de notre propre capacité cognitive.
Qu’est-ce que le « cygne noir » au juste ? Pour le dire simplement, si vous vous postez au bras d’une rivière où passent des cygnes, et que vous commencez à les compter, le nombre d’oiseaux blancs vous fera déduire que tous les cygnes sont blancs – jusqu’au jour où contre toute attente, un cygne noir apparaîtra. Autrement dit, le cygne noir, l’oiseau, est, dans cette histoire, le signe de la « dissonance statistique », le signe d’un accident d’autant plus inimaginable que tout a été prévu et calculé, mais accident qui arrive quand même, et dont les conséquences sont impensables. Plus précisément, un événement cygne noir possède trois caractéristiques principales : 1° la rareté : il s’agit d’un événement statistiquement aberrant, une anomalie qui contraste fortement avec les données courantes ; bref, c’est une occurrence qui « sort du lot » ; 2° l’ampleur de l’impact : c’est un événement aux conséquences extrêmes ; les cygnes noirs transforment profondément et durablement le paysage (politique, économique, social, écologique…); 3° l’imprévisibilité et la rationalisation a posteriori : les cygnes noirs ne peuvent être théorisés ou anticipés qu’une fois qu’ils se sont produits ; les catastrophes naturelles, les krachs boursiers ou encore les attentats terroristes relèvent de cette catégorie ; impossible de dire avec précision quand et où ils vont se produire bien qu’ils soient inévitables.
Pour Taleb, l’imprévisibilité des cygnes noirs réside dans un déficit de connaissance que nos méthodes de prévision traditionnelles ne peuvent combler, car elles sont trop tournées vers le passé. Peu importe la quantité d’informations disponibles ou la sophistication des modèles mathématiques employés, un cygne noir reste, par définition, imprévisible. Cette imprévisibilité, selon Taleb, relève finalement de la statistique ou de l’épistémologie, dans la mesure où notre capacité à connaître une situation dépend du type de distribution qui la régit, ainsi que du degré de complexité des décisions qu’elle implique. Taleb distingue ainsi deux types de décisions et deux types de distributions : les décisions simples et les décisions complexes, ainsi que les distributions à queue épaisse (fat tail) et les distributions gaussiennes (ou à queue étroite). Dans le cas d’une décision simple avec une distribution gaussienne, les méthodes traditionnelles de prévision (mathématiques, statistiques, etc.) fonctionnent bien. Cela vaut également pour une décision simple avec une distribution à queue épaisse. Lorsqu’il s’agit d’une décision complexe dans un univers à distribution gaussienne, ces méthodes restent efficaces. Cependant, pour ce que Taleb appelle le « quatrième cadran » – c’est-à-dire les décisions complexes dans un environnement à queue épaisse – ces outils de prévision deviennent inopérants. En résumé, les statistiques sont fiables dans trois cas sur quatre, mais ce quatrième cas représente le territoire des cygnes noirs, un véritable « angle mort » où ces événements se dissimulent, échappant à la vigilance des « banquiers et des experts de la prévision en chambre » (comme ils les appellent). Taleb compare ces derniers à « la dinde qui croit que le fermier vient tous les jours pour la nourrir, jusqu’au jour de Noël ! ».
Le « Cygne Sombre » et l’oubli fondamental
L’argument de Nassim Taleb pour expliquer l’imprévisibilité irrévocable des cygnes noirs repose en grande partie sur des considérations statistiques. Il explique que ces événements sont si rares et extrêmes qu’ils échappent aux modèles prédictifs basés sur des données historiques. Mais on peut envisager une interprétation différente, voire plus radicale, en s’inspirant de la « philosophie de l’événement » de Gilles Deleuze et Félix Guattari, notamment dans Mille Plateaux. Ce qui donne à peu près l’hypothèse de travail suivante : les cygnes noirs sont imprévisibles non pas seulement à cause de la rareté historique ou d’une carence d’information, mais parce qu’ils opèrent dans le cadre de ce que Deleuze et Guattari appellent un « oubli fondamental », un oubli qui n’a rien à voir avec le passé ou la mémoire traditionnelle.
Cet oubli fondamental se retrouve dans la structure narrative de la nouvelle (short story), un genre littéraire que Deleuze et Guattari explorent. Ils expliquent que la nouvelle se construit autour de la question « Qu’est-ce qui s’est passé ? », une interrogation qui reste irrésolue, laissant toujours une part d’inconnu. Les gens, selon eux, (Taleb le pense aussi), échouent en voulant rationaliser les choses après coup. Ils tentent d’encercler l’événement dans un cadre logique, en remontant de la fin vers le début, comme dans une forme d’ingénierie inversée où l’on essaye de reconstruire la trajectoire d’un événement imprévu. C’est ce que Taleb dénonce comme un « biais narratif », où l’on veut tout expliquer rétrospectivement, une démarche qui occulte l’essence de l’événement, son imprévisibilité.
Deleuze et Guattari, quant à eux, illustrent leur propos à travers la nouvelle de F. Scott Fitzgerald intitulée « The Crack-Up », dans laquelle l’auteur décrit un processus de dépérissement intérieur. Ce que Fitzgerald exprime, c’est une rupture, une fêlure intérieure qui reste imperceptible, fragmentée, échappant à toute explication causale nette. Comme les cygnes noirs, la fêlure décrite par Fitzgerald n’est pas un événement que l’on peut analyser de manière linéaire. Ce n’est qu’après coup que l’on perçoit l’effondrement, mais sans jamais pouvoir véritablement savoir « ce qui s’est passé ». Fitzgerald lui-même ne parvient pas à expliquer clairement ce moment de fracture, parce qu’il ne s’inscrit pas dans une continuité narrative stable – il relève d’une ontologie de l’événement qui, tout comme les cygnes noirs, résiste à toute totalisation discursive.
Taleb parle du « quatrième cadran », une zone d’incertitude totale, où résident des événements extrêmes qui échappent aux modèles et aux radars logico-statistiques. Ce cadran n’est pas un simple réservoir de possibilités, mais un champ de forces chaotiques, un espace virtuel où résident les potentialités inattendues. De la même manière, dans Mille Plateaux, Deleuze et Guattari évoquent cet angle mort de la perception humaine, un territoire où les cygnes noirs, bien qu’imperceptibles, se forment et attendent leur moment pour surgir. Ce territoire est comparable à une lumière ultraviolette ou infrarouge : bien que réel, il reste invisible à l’œil humain, qui ne peut percevoir qu’une infime partie du spectre.
En fin de compte, les cygnes noirs émergent de quelque chose d’inconnu, ou « oublié » dans le sens deleuzo-guattarien. Contrairement aux récits linéaires comme ceux des contes ou des romans policiers, où tout se résout à la fin, la structure narrative de la nouvelle, tout comme celle du cygne noir, fonctionne précisément parce qu’elle ne répond jamais entièrement à la question centrale : « Qu’est-ce qui s’est passé ? ». Que ce soit la fêlure intérieure d’un individu ou une crise mondiale, ces événements résistent à la rationalisation complète et continuent de défier notre capacité à les saisir pleinement, même après coup.
Il y a deux façons de connaître le monde, nous dit Taleb : « La première, par l’épistémologie et la statistique : essayer de comprendre ce que l’on sait en le modélisant. La seconde, en sachant voir ce qu’on ne comprend pas, en tenant compte de l’incertitude et du hasard sans perdre la rigueur statistique ». C’est pourtant ici que l’approche de Taleb révèle ses limites. Bien qu’il reconnaisse l’importance de l’incertitude radicale, son approche reste profondément ancrée dans un désir (idéal) de connaissance, que ce soit par des modèles « non-gaussiens » ou des analyses probabilistes sophistiquées (c’est son travail et son fonds de commerce, après tout, en tant que consultant en gestion des crises). Taleb cherche encore à comprendre et prévoir, même en intégrant l’imprévisible dans des modèles de connaissance. Là où Taleb continue à tenter de prédire l’avenir des choses à travers la compréhension statistique, Deleuze et Guattari nous invitent à observer non pas l’avenir des choses, mais leur devenir. Leur pensée ne cherche pas à connaître ou à modéliser l’événement, mais à scruter et sentir le devenir : le devenir-animal, le devenir-femme, le devenir-enfant, et, pourquoi pas, le « devenir-cygne-noir ». Ce dernier n’est pas un événement à saisir ou à prédire, mais un processus silencieux, un cheminement souterrain qui échappe fondamentalement à toute entreprise d’ordre épistémologique, nous forçant à accepter le flux chaotique et imprévisible du réel.