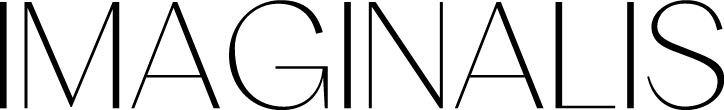- 11/12/2024
- By Soufiane Mezzourh
- 0 Comments
Le mythe du client roi
Dans l’imaginaire contemporain des entreprises, une figure s’est élevée au rang de divinité incontestée : le Client Roi. Sur tous les murs des salles de réunion, dans les formations au « leadership orienté client » et même jusque dans les signatures d’e-mails, ce personnage omniprésent est présenté comme le centre de toutes les attentions, celui pour qui tout doit être conçu, façonné, et (oserait-on dire ?) sacrifié. Mais derrière cette figure majestueuse se cache un mythe bien ficelé, dont les rouages méritent d’être dévoilés.
Le Client Roi n’est pas une personne, mais une construction. Une forme d’abord, bien sûr : on l’imagine souriant, satisfait, flânant dans les rayons d’un magasin ou explorant les pages d’un site web, son panier virtuel débordant de produits soigneusement recommandés par des algorithmes dévoués. Mais ce roi moderne ne porte pas de couronne (du moins pas une vraie) : il arbore un smartphone dernier cri et un air légèrement exigeant, prêt à traquer la moindre « expérience utilisateur » décevante. Peut-être râle-t-il à propos d’une pizza livrée sans supplément de roquette ou d’un colis arrivé avec 12 minutes de retard. Sa posture est universelle : un mélange de curiosité, d’impatience, et d’une touche d’autorité que seule l’anonymat d’un commentaire en ligne peut offrir.
Mais le mythe ne s’arrête pas à cette image. Derrière cette forme se cache un concept : celui d’une toute-puissance. Le Client est le maître absolu, celui dont chaque désir doit être anticipé, chaque critique entendue, chaque insatisfaction réparée sur-le-champ – et avec un code promo pour s’excuser, s’il vous plaît. L’entreprise moderne lui voue un culte obsessionnel : « le client a toujours raison », martèlent les slogans, comme si cette maxime sacrée venait directement des tables de la loi. Mais ce pouvoir est une illusion. Derrière ce trône symbolique, le Client Roi est en réalité un prétexte, une figure idéale que l’on brandit pour justifier les dérives les plus absurdes : restructurations, hyperconnexion, ou pression constante sur les employés sommés de « se dépasser pour offrir l’excellence ». Imaginez un service client surchargé, jonglant entre des tickets à résoudre en « moins de 3 minutes » et des formations sur « l’empathie sincère et automatisée ». Pas très royal tout ça.
Enfin, le mythe se révèle dans sa signification. Le Client Roi incarne bien plus qu’un consommateur satisfait : il est le pivot d’une idéologie néolibérale où tout, absolument tout, doit être orienté vers la performance et la rentabilité. Sa majesté devient une arme de management. Sous couvert de répondre à ses besoins (réels ou supposés), on multiplie les indicateurs de satisfaction, on accélère les livraisons, et on promet des retours gratuits sous 30 jours, quitte à ignorer les employés exténués ou les impacts environnementaux. Le Client Roi devient alors l’alibi parfait pour justifier une société de surconsommation et de gratification instantanée.
Dans les coulisses, cependant, les apparences sont trompeuses. Si l’on tend l’oreille dans les open spaces des services clients, on n’entend pas de révérences mais des soupirs d’agacement. Les employés, transformés en chevaliers du service après-vente, se plient en quatre pour satisfaire des exigences parfois démesurées, tout en sachant que la prochaine enquête de satisfaction risque de les reléguer à des scores médiocres malgré leurs efforts héroïques. Peut-on vraiment être un « roi » quand on est réduit à cliquer frénétiquement sur des étoiles dans une application après une livraison de burgers tièdes ? Le Client Roi, dans toute sa gloire supposée, n’est peut-être qu’un sujet comme les autres, prisonnier d’un système où l’apparence de pouvoir masque une soumission aux mécanismes du marché. Comme dans le conte d’Andersen, Les Habits neufs de l’empereur, il suffit de regarder d’un peu plus près – avec cette innocence impitoyable propre à l’enfant – pour comprendre que le Roi est nu : dépouillé de tout véritable contrôle, il n’est qu’un figurant dans un théâtre bien huilé où la satisfaction promise est souvent une chimère.
Le mythe du Client Roi est donc un miroir déformant, une fiction qui transforme la relation commerciale en un théâtre où tout est exagéré. Derrière les courbettes et les notifications enthousiastes – « Votre avis compte pour nous » – se cache une réalité bien plus prosaïque : un jeu de rôle où personne n’est vraiment roi, mais où tout le monde, employés comme clients, joue une partition imposée. Et si la clé pour comprendre ce mythe résidait dans une simple question : qui, au fond, sert qui ? Peut-être qu’à force de vénérer ce roi imaginaire, nous avons oublié que le véritable pouvoir se trouve dans la qualité des relations, et non dans la multiplication des couronnes en plastique.
Guy Debord, dans son court-métrage In girum imus nocte et consumimur igni, n’y allait pas par quatre chemins pour décrire ce qu’il appelait le « spectateur » : un fétichiste désespéré de ce qu’il consomme, réduit à servir frénétiquement un vide soigneusement emballé. Le Client Roi, dans cette perspective, n’est qu’un serviteur surmené, prisonnier d’un système qui lui promet tout et ne lui donne rien, si ce n’est l’illusion d’un choix et la quête infinie de la satisfaction. Et si, un jour, le marketing et la publicité arrêtaient leur propre fétichisme – celui de la consommation pour la consommation – alors peut-être que ce client-consommateur aurait enfin son mot à dire. Peut-être pourrait-il réfléchir à ce qu’il désire réellement, à ce qu’il consomme, et pourquoi. Et qui sait ? On viserait alors quelque chose de plus ambitieux que la simple satisfaction, ce graal du marketing : on parlerait peut-être de son bien-être, un vrai, durable, et dégagé des injonctions mercantiles. Encore un mythe, peut-être, mais un mythe qui, cette fois, aurait un goût moins amer.