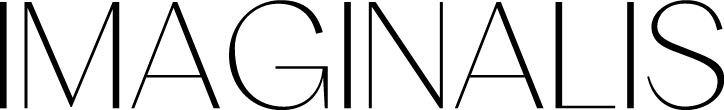C’est pourquoi Barbie semble perpétuellement « coincée » entre les deux, entre deux modèles qui ne fonctionnent pas en réalité : ni l’univers soi-disant « féministe » de Barbieland ni le patriarcat du monde réel ne permettent aux personnages de s’épanouir. Même dans un monde idéaliste comme Barbieland, où une femme noire est devenue présidente, certains n’y trouvent pas leur compte (une Barbie Bizarre stigmatisée, des Ken jaloux, le Ken de Ryan Gosling frustré…). Face à ce balancement entre deux réalités extrêmes, et finalement indésirables, Barbie flotte dans l’indécision : « I’m not really sure where I belong, I’m not sure I have an ending ». Et c’est ici que le film fait montre d’un métamodernisme assumé, car au lieu de trancher sur telle conviction ou telle idéologie, il nous invite plutôt à « sentir » le vertige de la situation, à osciller entre une extrême droite grotesque et une extrême gauche tout aussi craignos.